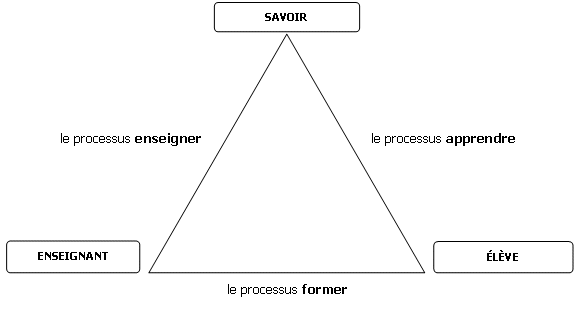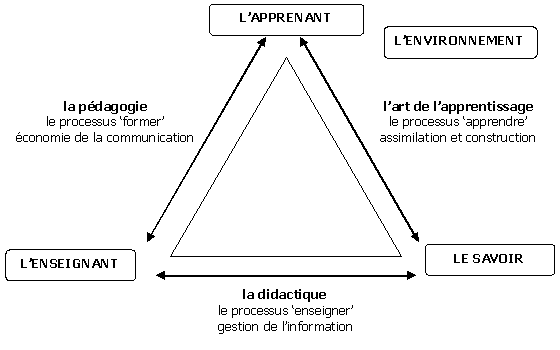1.
2 | Apprentissage et enseignement
1.
2 | Apprentissage et enseignement
Laisser à l’élève le soin de
résoudre le problème d’apprendre, c’est se soustraire
au devoir de résoudre le problème
d’enseigner.
B.F. Skinner
(1968 : 171).
1. 2. 1. Le savoir et les savoirs
1. 2. 2. Modèles ternaires de la situation d’enseignement–apprentissage
1.
2. 1. Le savoir et les savoirs
À chacun des différents niveaux
d’apprentissage évoqués dans les pages qui
précèdent, nous avons associé un type de
« savoir », du « savoir quelque chose »
au « savoir » tout court, en passant par le
« savoir-faire ». Il est bien évident
qu’apprendre, c’est toujours apprendre quelque chose, dans le but de
connaître, de « savoir ». Mais toute
l’ambiguïté de ce terme est qu’il apparaît en
amont comme en aval du processus « apprendre » ; le
savoir (S) désigne aussi bien
l’objet de l’apprentissage
(a) que son résultat, son
produit, selon l’équation :
S à a à S.
La situation se complique quand on sait que, pour les cognitivistes, le terme de
cognition, qui peut être considéré comme synonyme de
« savoir » ou « savoirs », recouvre
à la fois le processus
d’apprentissage et son produit. En effet, selon Le Ny,
la cognition recouvre à la fois
l’ensemble des activités qui concourent à la connaissance,
qu’elles fonctionnent de façon correcte ou plus ou moins correcte,
et l’ensemble des produits de ces activités, qu’il
s’agisse de connaissances proprement dites, d’erreurs franches, de
représentations et de croyances approximatives, ou partiellement
inexactes (1992 :
136)
52.
On constate que cette définition
s’éloigne considérablement de la conception traditionnelle
de l’apprentissage comme acquisition d’un savoir
préétabli, et de la conception corrélative de
l’enseignement comme « transmission des savoirs ». En
effet, l’auteur cité va jusqu’à considérer que
« les erreurs franches » et « les croyances
approximatives » non seulement concourent à la connaissance
mais qu’elles en font partie. Et
même si nous n’adhérons pas tout à fait au
regroupement des activités d’apprentissage et des connaissances en
un seul et même concept, il nous faut tout au moins reformuler notre
équation de départ, pour tenir compte du fait que le savoir acquis
n’est jamais l’équivalent exact du savoir à
acquérir : S
à
a
à
S’.
Or, dans le cadre de l’apprentissage par
instruction, la médiation de l’enseignant intervient sur le
« savoir savant » pour le didactiser
(
d), le transformer en
« savoir à faire apprendre », et notre
équation se transforme à nouveau pour donner :
S
à
d
à
S’à
A
à
S’’. Si nous nous
intéressons à l’apprenant
(
A) en tant que sujet de
l’apprentissage, nous tenons ici deux des trois côtés du
triangle pédagogique : le côté de la didactisation, ou
de la « transposition didactique »
(
S
à
d
à
S’) d’une part, et celui de
la pédagogie
(
S’à
A
à
S’’)
d’autre part.
1.
2. 2. Modèles ternaires de la situation
d’enseignement–apprentissage
— Le
triangle pédagogique
Arrivé à ce stade de notre
réflexion, il devient nécessaire de définir un terme
déjà utilisé à plusieurs reprises, celui de
« triangle pédagogique », que nous empruntons
à Houssaye (1988),
cf.
Figure 1.1 ci-dessous. La thèse de cet auteur est que la relation
triangulaire pédagogique fonctionne selon le principe du tiers exclu,
qu’il définit ainsi :
La situation pédagogique peut être
définie comme un triangle composé de trois éléments,
le savoir, le professeur et les élèves, dont deux se constituent
comme sujets tandis que le troisième doit accepter la place du mort ou,
à défaut, se mettre à faire le fou.
Les processus sont au nombre de trois :
« enseigner » qui privilégie l’axe
professeur-savoir, « former » qui privilégie
l’axe professeur–élèves,
« apprendre » qui privilégie l’axe
élèves–savoir ; sachant qu’on ne peut tenir
équivalemment les trois axes, il faut en retenir un et redéfinir
les deux exclus en fonction de lui (op.
cit. : 233).
Figure 1.1
- Le triangle pédagogique de J. Houssaye
— Une
approche ternaire de la formation
La littérature du domaine propose bien
d’autres modèles de la relation pédagogique, souvent
construits, comme le modèle de Houssaye, sur une forme ternaire. Dans
leur ouvrage sur l’autoformation, Carré
et al. (1997 : 34 et s.), qui font
allusion à la « problématique des trois
maîtres » d’un illustre devancier,
Rousseau
53,
proposent un modèle ternaire de la formation
(Figure 1.2).
Ces auteurs insistent sur la valeur heuristique de
l’approche ternaire, qui leur permet une analyse de chaque niveau de
l’autoformation, à la fois « polarisée sur un
aspect spécifique (psychologique, pédagogique, social) et
dialectiquement articulée aux trois autres ».
Corrélativement, la prise en compte de la dimension dialectique permet
d’échapper aux pièges du psychologisme, du sociologisme et
du
pédagogisme (ou
technicisme), qui guettent quiconque se focalise sur un seul des trois
pôles de la situation de formation (pour nous :
la situation
pédagogique).
Le modèle proposé par Carré
et al. accorde au
pôle de l’Environnement autant d’importance qu’aux
pôles du Sujet apprenant et du Dispositif de formation. Cette importance
accordée au pôle « éco » est
relativement nouvelle dans le domaine de la pédagogie, mais elle nous
semble surtout justifiée par le fait que, dans les milieux de
l’autoformation étudiés par ces auteurs, le Sujet apprenant
est typiquement un adulte, engagé dans un milieu socioprofessionnel qui
constitue un élément non négligeable de son environnement
d’apprentissage. L’influence du facteur
« sociopédagogique » nous semble moins importante
dans le cadre de l’apprentissage institutionnel traditionnel qui est celui
de notre présente étude. Par ailleurs, la fusion
opérée dans ce modèle entre l’enseignant et les
supports d’apprentissage, sous l’étiquette commune de
« dispositif de formation » nous paraît
préjudiciable à l’analyse de ce qui fait la
spécificité du dispositif humain d’une part et des
dispositifs non humains d’autre part. Comme le fait remarquer Springer,
« le fait de classer l’enseignant dans la catégorie des
ressources et des moyens peut déranger et choquer »
(1996 : 166). Nous admettons volontiers que, du point de vue de
l’apprenant, l’enseignant puisse être considéré
comme une ressource parmi d’autres. Ce qui nous choque dans ce
regroupement, c’est que, en mettant sur le même plan
l’enseignant et les ressources, il ne met pas en évidence les
rôles distincts joués par l’enseignant dans la
médiatisation du savoir (la didactisation des ressources) et la
médiation pédagogique.
— Un
modèle systémique
Figure 1.3
–Le modèle systémique d’Altet
Un
troisième modèle, dont on peut considérer qu’il
complète celui de Houssaye en explicitant les champs de la didactique et
de la pédagogie, est le modèle systémique proposé
par
Altet (1997 : 15-17,
Figure 1.3 ci-dessus). Ce modèle, qui décrit la
pédagogie comme « la régulation fonctionnelle et
dialectique entre les processus enseigner–apprendre,
apprendre–enseigner [...], met l’accent sur la dynamique de la
régulation pédagogique qui est plus de l’ordre du flux, de
l’énergie et du temps que de l’équilibre entre des
pôles » (Altet, 1991, cité par Altet,
1997 : 15). L’approche systémique a été
vulgarisée par des auteurs comme De Rosnay (1975), et appliquée au
domaine pédagogique par Gagné (1975, cité par Altet,
op. cit. : 16).
D’après Lerbet, « [l’approche systémique]
n’occupe pas encore en éducation la place souvent
prépondérante qu’elle peut avoir dans d’autres
disciplines comme, par exemple, les sciences de la cognition »
(1997 : 5). Tout en regrettant que la référence aux
systèmes et à la systémique soit devenue une mode qui
suscite « des discours parfois péremptoires »,
Demaizière et Dubuisson retiennent que, « sans être une
science ou une théorie à laquelle se référer
nécessairement », la systémique est
« liée à une démarche qui se révèle
utile [...] dans le champ de l’utilisation des
NTF54
dans la formation » (1992 : 151).
D’après De Rosnay, tandis que
l’approche analytique convient bien à l’analyse des
systèmes homogènes, « c’est-à-dire
comportant des éléments semblables et présentant entre eux
des interactions faibles, [...] les lois d’additivité des
propriétés élémentaires ne jouent [...] plus dans le
cas des système de haute complexité, constitués par une
très grande diversité d’éléments liés
par des interactions fortes » (1975 : 118). Il nous
apparaît que la diversité des éléments qui composent
ce système complexe qu’est la situation
d’enseignement–apprentissage, ainsi que les interactions fortes qui
lient ces éléments entre eux, rendent l’approche
systémique particulièrement appropriée à
l’étude d’un tel système.
— Le
modèle SOMA de Legendre
Dans son
Dictionnaire actuel de
l’éducation55,
Legendre définit un modèle de
situation
pédagogique56
qui comporte quatre composantes :
- le
sujet (S) : l’être humain mis en situation
d’apprentissage (que nous appelons l’apprenant) ;
- l’objet
(O) : les objectifs à atteindre (pour nous, le savoir) ;
- le
milieu (M) : l’environnement éducatif humain (enseignant,
orienteurs, conseillers, etc.), les opérations (administratives et
d’évaluation) et les moyens (locaux, équipements,
matériel didactique, temps, finances) ;
- l’agent
(A) : les « ressources d’assistance » telles que
les personnes (enseignant, autres élèves), les moyens (livres,
matériel audiovisuel, etc.) et les processus (travail individuel ou
collectif, cours magistral, etc.) (Legendre, 1988, cité par Germain,
1989,
passim).
Ce
modèle de la situation pédagogique, adapté au domaine de la
didactique des langues par Germain, est illustré par le schéma de
la Figure 1.4 (ci-dessous) .
La relation pédagogique, qui se trouve au centre
de la situation pédagogique, se définit comme
« l’ensemble des relations d’apprentissage,
d’enseignement et didactique dans une situation
pédagogique » (Legendre,
op. cit. : 491).
Par rapport au modèle de Carré, celui de Legendre présente
l’avantage de ne pas faire de l’environnement un pôle parmi
les trois pôles de la situation pédagogique, mais un Milieu qui
inclut les trois autres pôles. En
revanche, la position de l’enseignant paraît peu claire,
puisqu’on le retrouve aussi bien en tant que composante de l’Agent
que comme composante du Milieu. D’ailleurs, ces deux composantes Agent et
Milieu semblent se recouper. Nous reviendrons sur ce modèle lors de notre
discussion d’un modèle de la situation pédagogique propre
à l’apprentissage des langues.
Figure 1.4
– Le modèle
SOMA de la situation
pédagogique (Legendre, 1988, adapté à la didactique des
langues par Germain, 1989)
— Un
modèle provisoire
Nous proposerons un premier modèle, basé
sur le triangle pédagogique de Houssaye, de qui nous avons
conservé provisoirement la terminologie des trois
« processus » : apprendre, enseigner et former
(
Figure 1.5). Nous y
intégrons le champ de la didactique, que nous associons à la
gestion de l’information et celui de la pédagogie, qui
relève de l’économie de la communication
(d’après Lerbert, 1984 : 33). Pour faire pendant aux deux
champs
57
de la didactique et de la pédagogie, nous proposons, à
défaut d’oser le néologisme
d’« apprentique », mais pour tout au moins mettre en
évidence le point de vue
émique de notre
approche, « l’art de l’apprentissage ». Les
flèches doublement orientées qui relient les trois pôles de
notre modèle symbolisent la stabilité dynamique, les
équilibres de flux, l’interaction, caractéristiques
empruntées à l’approche systémique. Enfin, nous
attribuons provisoirement une place « flottante » à
la composante Environnement de la situation pédagogique, place qui
demandera à être affinée ultérieurement.
Ce premier modèle va nous permettre de discuter
des rapports entre pédagogie et didactique, termes soit souvent confondus
dans l’usage courant soit au contraire revendiqués comme distincts,
voire opposés par les spécialistes des champs qu’ils
désignent.
Figure 1.5
– Un premier modèle de la situation
d’enseignement–apprentissage